Qu’est ce que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est l’expression des principes du développement durable à l’échelle de l’entreprise. Elle signifie que les entreprises, de leur propre initiative, contribuent à améliorer la société et à protéger l’environnement, en liaison avec les parties prenantes. De plus en plus d’entreprises reconnaissent leurs responsabilités sociétales en mettant en œuvre des dispositifs au sein de leur structure et avec leurs parties prenantes. Comment décliner un concept d’intérêt général ou de développement durable au niveau de l’entreprise ? Explications dans cet article…
Démarche RSE et entreprises françaises
En fait, le développement durable permet à l’entreprise de “sortir du seul prisme financier”. En considérant l’ensemble des conséquences de son activité. Une entreprise ne s’intéresse plus seulement à la performance économique, mais aussi à la performance sociale et environnementale.
L’entreprise s’attache à faire croitre 3 capitaux et non plus un seul comme auparavent :
- son capital économique : capital au sens traditionnel
- son capital social : capacité à améliorer les conditions des salariés et sous- traitants
- son capital environnemental : capacité à réduire son impact sur la nature
La RSE, une politique de long terme
Investir sur ces 3 capitaux (économique, social, environnemental) ne donne pas de plus-value automatique à court terme. Il faut savoir aussi communiquer en interne et en externe et projeter sa politique à long terme. C’est aussi un pari gagnant sur l’avenir, car les sociétés qui auront anticipé ne seront pas lourdement pénalisées par les futurs changements de règlementations environnementaux. Attention tout de même à ne pas tomber dans le greenwashing !
Un des leviers importants agissant sur le comportement socialement responsable des entreprises, est celui du financement. L’investissement socialement responsable (ISR), c’est-à-dire la gestion de fonds éthiques qui intègre des critères de nature sociale et environnementale aux critères financiers classiques, se développe rapidement ces dernières années. Les fonds institutionnels, comme le Fond de réserve des retraites, ont des objectifs à long terme qui correspondent bien aux valeurs du développement durable. Ils représentent des montants importants qui s’orientent progressivement vers l’ISR.
Le développement de la RSE et de l’ISR rend nécessaire d’améliorer l’information non financière. L’article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) demande aux entreprises françaises, cotées sur le marché français, d’inclure dans leur rapport annuel un compte-rendu des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités.

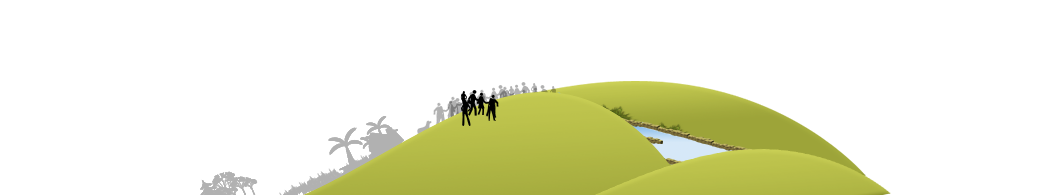






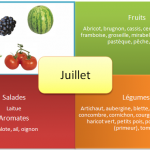












Sans tomber dans le catastrophisme, j’ose prétendre que, nous, l’Humanité, allons droit dans le mur ou plutôt dans trois murs : un mur environnemental, un mur social et un mur économique. L’un après l’autre, dans un ordre ou un autre, ou les trois simultanément. Les experts prévoient que le mur environnemental provoqué par la pénurie de combustibles fossiles sera atteint avant les autres et provoquera les deux autres effondrements.
Dans 40 ans, nous aurons par notre consommation de 30 milliards de barils par an, épuisé les réserves de pétrole conventionnel connues à ce jour. Il en est à peu prêt de même pour le gaz et l’uranium, pour le charbon nous avons encore plus d’un siècle devant nous.
Les conséquences de ces pénuries annoncées sont prévisibles : augmentation des prix de ces matières premières, crises économiques dues à la spéculation, crises sociales, révolutions, guerres économiques ou militaires. Ceux qui vont en subir le plus les impacts, en dehors des populations défavorisées, sont nos descendants directs, nos enfants et nos petits enfants. De plus, tous les indicateurs sont déjà au rouge : crise financière, effondrement des bourses, faillites des banques et même potentiellement de pays, catastrophe du golfe du Mexique, catastrophe nucléaire au Japon, révolutions dans les pays arabes, troisième choc pétrolier, etc ..
Tous ces évènements actuels ont nécessairement des impacts sociaux très importants de part le monde. Outre les pénuries annoncées, il est prouvé maintenant que le CO2 rejeté est à l’origine d’un réchauffement anthropique de la planète. Phénomène extrêmement complexe non maitrisable pour lequel les experts redoutent en plus un risque d’emballement.
Tout cela débuta vers 1850 : pétrole, charbon et gaz naturel sont utilisés au départ pour développer l’industrie puis plus tard pour produire de l’électricité. Le mouvement s’est prodigieusement accéléré après la deuxième guerre mondiale, du moins pour les pays dits développés. Depuis, nous consommons abusivement et cette consommation se sert abondamment et quasiment uniquement des ressources énergétiques fossiles (92 %). L’augmentation prévue de la population mondiale dans les décennies à venir ne peut qu’aggraver la situation.
Et pourtant les sonnettes d’alarme ont été tirées depuis longtemps. Nous consommons trop depuis environ 60 ans et, en 1970 soit 20 ans environ après le début de la frénésie, à la demande du club de Rome, le rapport Meadows pose déjà la question rien que par son titre “Halte à la croissance ?”. C’était il y a 40 ans. Ce rapport prévoyait une augmentation de la production, de la consommation et de la pollution jusqu’en 2030. Selon les auteurs, les raréfactions de matières premières prévues entre 2010 et 2030 provoqueront des crises majeures. Puis à cause des épuisements de ces matières premières un effondrement du système subviendra vers 2030 et nous assisterons même une diminution de la population mondiale à partir de 2050. A ce jour, nombre d’économistes considèrent que le rapport n’est malheureusement que trop d’actualité.
Du constat de la finitude de toute ressource est né le concept de développement durable.
Ce concept initialement scientifique va évoluer lors des sommets de la Terre de Stockholm (1972) et de Rio (1992). Ce sommet de 1992, considéré comme déclencheur, produit l’agenda 21 et une déclaration en 27 principes. Entre les deux sommets parait le rapport Bruntland demandé par le secrétaire général de l’ONU à l’ex ministre(e) de l’environnement de Norvège. A cette période l’accent est mis sur la nécessité de la création d’institutions nationales et internationales. Les politiques se sont appropriés le concept.
En parallèle et sur le volet social, émerge un autre concept : celui de la responsabilité sociale de l’entreprise. Outre Atlantique, après la deuxième guerre mondiale le Federal Council of Churches of Christ in America s’inquiète de l’évolution de l’éthique des affaires et commande une étude qui sera formalisé par Howard Bowen en 1953 dans ce que l’on peut appeler la ‘Bible’ de la RSE : “Social Responsibilities of the Businessman”. Dans ce livre, Bowen met en cause le ‘laisser-faire’ et les impacts sociaux des décisions des gérants d’entreprises qui privilégient les profits au détriment du welfare (bien-être) des employés. Il s’interroge également sur la redistribution des profits de l’entreprise.
La responsabilité, c’est littéralement la capacité à répondre (response ability en anglais), à rendre compte, mais aussi à s’engager en retour (re-spondeo). Le sujet est éminemment philosophique et trouve ses racines de Platon à Hans Jonas (Le principe responsabilité 1979).
Mais deux personnages plus récemment vont permettre au développement durable et à la responsabilité sociale de se rejoindre.
Dès 1997, John Elkington forgera la relation entre l’environnement, le social et l’économie dans son livre ‘Cannibals with forks, the triple bottom line of the 21th century’, qui popularise la règle des 3 P : Planète, Peuple, Profits (écologie, social, économie) qu’il convient de ne pas considérer de manière séparée. Lorsqu’on tient compte des 3 P simultanément et qu’on les équilibre, on favorise le Progrès. En résumé, il est souhaitable de faire des affaires et même du profit en limitant ses impacts sociaux et environnementaux. Voire même, faisons du profit en basant les affaires sur des avancées sociales et environnementales. En évoquant le triple bilan (bottom line), Elkington insiste sur la nécessité de publication des résultats sociaux et environnementaux en plus des résultats financiers. Il prévoit même que la concurrence au 21ème siècle se fondera sur des performances sociales et environnementales.
Edward Freeman affine depuis 1984 sa théorie des parties prenantes (stakeholder, ce qui détient un enjeu dans l’entreprise ou pour qui l’entreprise est un enjeu, en opposition à shareholder – actionnaire – ou bondholder – obligataire). Il convient de les organiser, de les classer, de les qualifier, puis d’évaluer le dialogue nécessaire avec ces parties prenantes afin de prendre en compte leurs intérêts. De plus, cette théorie implique que la responsabilité sociale ne se cantonne pas à l’entreprise elle-même, mais se propage aux parties prenantes. Plus question de déléguer la responsabilité d’un échec à un sous-traitant par exemple. La création de valeur ajoutée doit être partagée et n’est optimale que lorsque toutes les parties prenantes en bénéficient.
Des deux approches vont émerger des principes communs forts :
– la nécessité de rendre compte et l’obligation d’une transparence claire, juste et exhaustive
– la recherche de l’exemplarité, la vigilance, l’amélioration continue et l’auto-évaluation
– et l’ouverture de la gouvernance aux parties prenantes
Mais tout cela reste bien abscon et manque d’outils et de méthodologie applicable au quotidien. Ce fut l’objet de la demande des associations de consommateurs à l’ISO qui y travailla de 2005 à fin 2010 et aboutit à la publication de la norme internationale ISO 26000. Ce texte reprend les principes énoncés ci-dessus et rajoute la prise en compte des principes des grands textes universels que sont la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), mais rajoute aussi la lutte contre la corruption, le respect de la légalité en vigueur et la protection des consommateurs.
Cette norme hors norme, utopique selon certains, gauchiste pour d’autre, propose à toute organisation, publique ou privée et de toute taille, un cadre d’auto-évaluation de sa responsabilité sociale et environnementale, c’est-à-dire un questionnement basé sur la prise de conscience et l’amélioration continue, et ce en croisant 7 questions centrales et 7 principes.
Elle reprend également la théorie des parties prenantes de Freeman et ajoute la notion de sphère d’influence, c’est-à-dire l’ensemble des parties prenantes sur lesquelles l’organisation concernée à la capacité d’influer sur leurs décisions et activités et ainsi propager la responsabilité sociale.
Les 7 questions centrales sont relatives :
– à la gouvernance de l’organisation
– aux droits de l’Homme
– aux relations et conditions de travail
– à l’environnement
– aux bonnes pratiques des affaires
– aux consommateurs
– et à l’engagement sociétal
et les 7 principes de la responsabilité sont ainsi définis :
– rendre compte des impacts de l’organisation sur la société et l’environnement,
– être transparent sur les décisions qui ont une incidence sur la société et l’environnement
– adopter et favoriser un comportement éthique
– respecter les parties prenantes
– respecter la légalité
– respecter les normes internationales de comportement, notamment lorsque la légalité locale ne cadre pas ces comportements
– respecter les droits de l’homme
Le croisement entre questions centrales et principes fournit 36 domaines d’actions pour lesquels l’organisation doit évaluer sa performance et la mettre en regard de son importance ou sa criticité. De cette analyse en est déduit un programme d’actions qui normalement doit privilégier les domaines d’action critiques pour lesquels l’organisation est peu performante et planifier sur des arbitrages budgétaires les actions moins critiques ou sur lesquels la performance de l’organisation est correcte mais peut être améliorée
Enfin, la norme incite à propager la prise en compte de la RSE au sein de l’organisation et de toutes les parties prenantes.
Au delà d’une analyse qualitative de la performance sociale et environnementale d’une organisation, cette norme fournit un outil de définition de stratégie évolutive et pourrait même constituer le fil conducteur d’un programme politique. Certains vont même jusqu’à l’appliquer à leur propre foyer.
Le consensus autour de la démarche dépasse largement les clivages politiques même si la jeunesse de la norme laisse prévoir des ajustements à venir. Néanmoins, nombreux sont ses détracteurs parmi lesquels les sempiternels adeptes de la main invisible du marché, les héritiers de Friedman et de Von Hayek (deux prix Nobel d’économie 1974 et 1976), ou le Tea Party aux US. Selon Platon et sa version du mythe de Gygès, l’invisible est irresponsable. J’en déduis que le marché est irresponsable, que l’opacité c’est la responsabilité limitée et que la transparence engage la responsabilité.
L’histoire récente des concepts de développement durable et de la RSE met en évidence une prise de conscience d’abord scientifique (années 70), puis politique (années 80) et enfin économique en impliquant les entreprises (années 90/2000). La norme ISO 26000 l’étend à toute organisation de toute taille, publique ou privée, même si elle différencie l’Etat qui doit assumer avant tout une triple responsabilité légale, juridique et politique.
L’individu ou le citoyen est nécessairement une des parties prenantes d’au moins une organisation, soit en tant qu’employé, en tant que client, consommateur ou usager voire en tant qu’actionnaire. Par cette volonté d’extension aux organisations, il semble évident que l’individu est la cible finale de cette démarche, afin que lui aussi réduise ses impacts sociaux et environnementaux. Et pour atteindre l’ensemble des individus, la RSE se doit de rentrer par toutes les portes de la société et de toutes les organisations pour ainsi faire prendre conscience et faire prendre conscience de la nécessité de prise de conscience.
Nous devons donc tous, entreprises, institutions,associations, individus réduire nos empreintes sociales et environnementales au quotidien dans un but qui semble évident mais pour l’instant pas clairement exprimé : il s’agit de repousser dans le temps le choc contre les trois murs que nous sommes condamnés à percuter de toutes façons, mais plus ou moins violemment. Ce gain de temps permettra de trouver des solutions de remplacement raisonnables, d’inverser la tendance de 80 % de ressources non renouvelables utilisées pour produire de l’énergie et d’anticiper les conséquences sociales. Nous aurons, par exemple, le temps de convaincre qu’il vaut mieux arrêter de jouer aux apprentis sorciers en exploitant les gaz de schistes et les schistes bitumineux ou en développant les centrales nucléaires de IVème génération, notamment celles à neutrons rapides (du type SuperPhenix à Creys-Malville démantelée en 1998 qui en était le prototype industriel).
Nous sommes à la mi-temps du match. Quarante ans se sont écoulés, il nous reste quarante ans ou un peu plus pour développer les alternatives, et imaginer une société sans combustibles fossiles. Nos descendants nous en serons reconnaissants. En parallèle, toutes les initiatives sont bonnes à explorer, je pense notamment à :
– l’éco-efficacité qui consiste à penser selon les 4 R : Réduire, Ré-utiliser, Recycler, Respecter,
– l’éco-innovation, qui peut être définie par “la mise sur le marché de nouveaux produits ou procédés qui offrent une valeur ajoutée pour les affaires et les consommateurs en réduisant considérablement les impacts environnementaux”
– l’éco-conception qui prévoit le recyclage ou la réutilisation avant la fabrication
– l’économie sociale et solidaire
et surtout favoriser le développement et l’optimisation de toutes les énergies renouvelables et propres.
Par exemple, on peut comparer les puissances des premières centrales nucléaires des années 1950 qui étaient de 5 à 10 MW à celle d’une éolienne off-shore de dernière génération qui fournit 7MW. N’oublions pas que la plus grosse centrale nucléaire et la plus importante source d’énergie qui nous éclaire quotidiennement est en fonctionnement depuis longtemps et pour longtemps encore. Enfin, ne critiquons pas telle ou telle initiative sans avoir en en main l’analyse du cycle de vie total : de la conception au démantèlement.